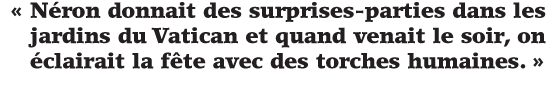les plus quotidiens et s’appuie sur la psychologie des acteurs historiques. En écrivant How the Irish Saved Civilization, Sailing the Wine-Dark Seas et Mysteries of the Middle Ages, qui vient de paraître en poche, cet historien américain a accompli ce que tous les professeurs poussiéreux de toutes les universités du monde n’ont jamais réussi à faire : nous intéresser à l’histoire ancienne. Vice : Le Moyen Âge a mauvaise presse, surtout les premiers siècles. On dit que c’est une époque obscurantiste, sombre, pleine d’épidémies et de violence. Mais votre livre a l’air de vouloir prouver le contraire. Thomas Cahill : Notre vision du Moyen Âge nous vient de la Renaissance. À cette époque, les gens se sentaient obligés de tout nommer et normer. Ils se considéraient comme des humanistes mais, quand on y réfléchit, c’étaient plutôt des philologues. Ils ont appris le grec, que peu de gens connaissaient dans le bas Moyen Âge, et se sont mis à traduire les textes qui avaient été conservés ici ou là, en partie par des scribes irlandais mais principalement par des érudits du Moyen-Orient. Et quels textes grecs étaient populaires ? Platon était le seul Grec connu. Par exemple, Saint Augustin, le philosophe le plus important du bas Moyen Âge, était platonicien. Et la vision du monde de Platon était très sombre. Il disait que l’humanité vivait dans une grotte, que tout ce qu’on voyait n’était pas réel—qu’on n’en voyait que les ombres. Je me demande pourquoi on a suivi les idées de Platon aussi longtemps. Le monde antique—le nôtre, la Grèce et Rome—était très pessimiste. C’est l’introduction de la pensée judéo-chrétienne et sa foi en l’avenir qui a vraiment fait changer les choses. Les Antiques pensaient que tout allait très mal finir. La plupart des Grecs croyaient que la meilleure chose à faire de son corps était de s’en débarrasser le plus vite possible. Pour eux, l’homme était un esprit emprisonné dans de la matière, dont il fallait s’échapper. Alors seulement on rejoindrait le Tout—mais qui sait ce qu’ils entendaient par là ? Dans le bas Moyen Âge, les gens se disaient : « Ok, quand les Grecs parlent du Tout, ils veulent dire Dieu. » C’est une vision assez orientale. Tout à fait. Je suis certain que les idées de Pythagore—le grand prédécesseur de Platon—viennent du même courant que le Bouddhisme. Mais ces origines se sont perdues. Vous pensez qu’il y a un ancêtre commun à Pythagore et aux Bouddhistes ? Complètement. Ils sont bien trop similaires. Ils partagent en fait les mêmes idées sur la matière et l’esprit mais aussi sur les nombres et les mathématiques. Ce n’est pas un accident. Les deux premières grandes civilisations, la Grèce et l’Inde, se sont forcément influencées mutuellement. En Grèce, le discours minoritaire serait celui d’Aristote. C’est lui qui a compris que Platon ne racontait que des conneries. En gros, il disait : « Je suis un disciple de Platon. Il est très intelligent mais il s’est trompé. Il n’y a pas de problème avec l’âme humaine, ni avec nos sens. La réalité est devant nous, on la voit, on l’entend. Oui, on fait parfois des erreurs, mais on ne vit pas dans une grotte de ténèbres. Notre existence est réelle ! » Aristote a vraiment poussé l’idée selon laquelle ce qu’on voit et ce qu’on entend est bel et bien réel. Ce sont un peu les origines de la recherche scientifique ? La science, dans le sens de mener des expériences, n’existait pas encore, mais oui, on observait des phénomènes. Et Saint Augustin ? C’est le premier philosophe du Moyen Âge ? Oui, et complètement platonicien. Bien que chrétien. Ces deux choses s’opposent, donc ? On pourrait le croire, sauf que le monde où est né le christianisme était grec. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Le latin est arrivé plus tard. Au premier siècle, on parle grec. Le type qui vend des sandwiches au coin de la rue doit connaître un peu de grec pour s’en sortir. Tout le monde le parlait. Une minorité absorbe forcément les idées de la culture dominante. On ne peut pas se fermer complètement. C’est ce qui rend fous les intégristes musulmans, et les intégristes de toutes les religions, d’ailleurs. L’idée que leurs enfants peuvent être influencés par des idées différentes des leurs les rend malades. Donc, même à son époque, Saint Augustin était influencé par la culture grecque et incorporait les idées de Platon dans sa propre philosophie. Oui. Sa vision du christianisme est sinistre, antisexuelle. Dommage. J’aime bien Saint Augustin pour plusieurs raisons. Son latin est très beau, notamment. C’est dur de le détester. En revanche, je n’apprécie ni Platon ni sa philosophie. Qui a succédé à Aristote ? Au XIIe siècle, il y avait Abélard. Une personnalité peu engageante—trop arrogant—mais c’est le premier philosophe du Moyen Âge qui donne raison à Aristote. Puis au XIIIe siècle, Saint Thomas d’Aquin, beaucoup plus pacifique, a vraiment développé ses idées. À l’époque, tout Aristote avait été traduit en latin. Du coup, la philosophie et la science ont explosé. Aristote écrivait beaucoup sur la Science et l’Histoire. C’est lui qui a inventé la métaphysique. Le terme lui revient. La séparation du savoir par discipline vient aussi de lui. Il a créé le classeur à intercalaires du monde occidental.On n’a pas encore parlé des Romains. Ils n’étaient pas aussi philosophes que les Grecs. La société romaine était plus cruelle. Jusque dans leurs divertissements. Oui, ils allaient quand même regarder des gens se faire dévorer par des lions. Néron donnait des fêtes surprises dans les jardins du Vatican et quand venait le soir, on éclairait la fête avec des torches humaines. Les gens se baladaient, buvaient et mangeaient en étant illuminés par les corps d’hommes et de femmes qu’on avait empalés et recouverts de goudron, puis immolés. Le cirque impérial était tout aussi cruel. Vous montrez dans votre ouvrage qu’il y avait une sorte de culture du vedettariat au Moyen Âge. Par exemple, il y a un chapitre entier sur Hildegarde, cette femme qu’on a cloîtrée quand elle était jeune fille—et quand je dis cloîtrée, littéralement enfermée dans une cellule à l’intérieur d’une église—et qui est pourtant devenue une véritable personnalité, faisant des discours publics et influençant l’opinion. Oui, il y avait déjà des célébrités. Certains personnages sont devenus très importants. Quand Hildegarde s’est rendue en Rhénanie pour faire des sermons dans les églises, les salles étaient pleines. D’abord, personne n’avait jamais entendu une femme s’exprimer en public. Et puis ce qu’elle avait à dire était si différent, si habité. Qui serait l’équivalent d’Hildegarde aujourd’hui ? Barack Obama [rires] ? Il fait toujours salle comble, non ? How the Irish Saved Civilization raconte l’histoire des érudits irlandais qui ont sauvé beaucoup de textes de l’Antiquité. Ça commence après la chute de l’Empire romain. Rome tombe sous le coup des invasions barbares. Mais je pense que les barbares n’étaient en réalité que des immigrants qui voulaient entrer, même si c’est vrai qu’ils étaient très primitifs. Pour eux, les livres servaient à faire du feu. À ce moment-là, du moins en Europe, il n’y avait plus de livres. Vers le sixième ou septième siècle, on compte seulement deux bibliothèques pour tout le continent. Il y en avait probablement plus, mais seule l’existence de ces deux-là est certifiée. Comment les Irlandais sont-ils entrés dans l’Histoire ? Saint Patrick a converti les Irlandais à la religion chrétienne et s’est rendu compte qu’il devait leur apprendre à lire et à écrire pour que ça reste. Leur manuel scolaire, c’était l’histoire des martyrs romains. Ceux qui étaient morts dans l’arène, dévorés par les lions. Les Irlandais aimaient le sang et ont adoré ces histoires, mais ils ont surtout aimé l’apprentissage. Ils étaient très scolaires et aimaient bien recopier les manuscrits. Leur réputation s’est répandue dans toute l’Europe. Des moines, qui venaient d’endroits comme le désert égyptien, arrivaient à Cork avec toute leur bibliothèque. Ils savaient que leurs textes seraient en sécurité en Irlande.