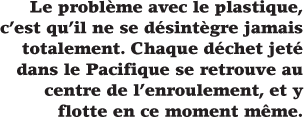Je ne suis pas du genre à coincer des inconnus pendant un dîner pour m’épancher sur le biodiesel ou pour les traiter de pauvres cons s’ils émettent des doutes sur la réalité du réchauffement climatique. Mais je ne suis pas non plus du genre à déclarer que je me fous du sort des baleines.

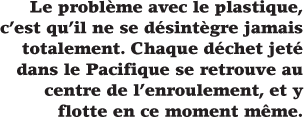 Le problème avec le débat sur l’écologie, c’est que personne ne comprend vraiment de quoi il retourne. Se forger une opinion sur les changements climatiques, la surpopulation ou le pic pétrolier, c’est se fonder sur des divergences statistiques tellement microscopiques que même les scientifiques ont du mal à comprendre. Tout est tellement confus qu’on voudrait parfois qu’il arrive quelque chose de franchement horrible pour mettre tout le monde d’accord. Un truc grave qu’on pourrait prendre en photo et commenter comme ça : « T’as vu ? On est niqués. » Ce truc, j’en ai été témoin : une partie de l’Océan Pacifique est condamnée à être en permanence saturée de déchets. Je l’ai vu de mes propres yeux.
Au milieu des années 1990, Charles Moore rapatrie son catamaran de course de Hawaii à la Californie. Pour rigoler, il décide de passer par le centre de l’enroulement du Pacifique Nord. L’enroulement est un énorme vortex de courants qui tourbillonnent autour d’une zone de haute pression constante—si vous vous représentez le reste du Pacifique comme une énorme cuvette de WC, cette zone est l’endroit où votre merde tournoie à la surface avant d’être aspirée. Mais comme cet endroit est un piège mortel sans un pet de vent, les bateaux l’évitent soigneusement. Quand Moore l’a traversée, il n’y avait que lui, son équipage et une traînée infinie de déchets.
Le centre de l’enroulement a toujours été une zone d’accumulation naturelle pour toutes les saloperies à la dérive. Il était une fois des épaves qui flottaient en cercle autour de l’enroulement et qui—parce que jusqu’au siècle dernier tout ce qui existait était biodégradable—se transformaient en un ragoût riche en nutriments, boustifaille idéale pour les poissons et les petits invertébrés. Puis on s’est mis à tout fabriquer à partir du plastique, ce qui a bouché les toilettes, pour filer la métaphore.
Le problème avec le plastique, c’est qu’il ne se désintègre jamais totalement. On peut, à la rigueur, le compacter jusqu’à ce qu’il ait la taille d’un diamant. Avec le temps, le plastique est entièrement photodégradable, jusqu’à ses polymères individuels. Mais ces petits trucs sont toujours là, et pour longtemps. Ça veut dire qu’à part quelques poignées de plastique biodégradable, toutes les molécules synthétiques jamais créées ne disparaîtront jamais. Et, mis à part le faible pourcentage qu’on retrouve pris dans un filet ou échoué sur le rivage, chaque morceau de plastique jeté dans le Pacifique se retrouve au centre de l’enroulement et y flotte en ce moment même.
Après avoir passé près d’une semaine à observer les déchets s’amasser contre la coque de son embarcation, le capitaine Moore a décidé de transformer son bateau en navire de recherche, et de se rendre deux fois l’an à l’enroulement pour y étudier les déchets. Je l’ai accompagné lors de son dernier voyage. L’équipage était composé d’un docteur, quarantenaire, divorcé, et d’une chimiste mexicaine, mère de deux enfants. C’était comme des vacances en famille, en plus scientifique et plus compliqué à organiser. La nappe de déchets se trouve à l’un des points les plus éloignés du monde. Il faut une bonne semaine en mer rien que pour s’y rendre. On sait combien une journée en voiture peut être une torture, alors on imagine bien les dégâts au cerveau que peuvent provoquer sept jours à bord d’un bateau de 25 mètres. Le premier jour, on perd de vue la terre ferme, puis on ne voit plus les autres bateaux, puis on ne voit plus rien à part des vagues à perte de vue et parfois un oiseau de mer. Après des jours à ne voir rien que de l’eau, une mouette devient aussi palpitante qu’un OVNI. Juste quand on se retrouve avec une chanson différente pour chaque oiseau recensé dans le guide du bateau et qu’on les a toutes rassemblées pour en faire un opéra dédié aux oiseaux de mer, on aperçoit les déchets.
J’ai pensé spontanément, sans me servir de mon bon sens, que le capitaine nous conduirait vers une masse de déchets contigus, mais ce n’a (malheureusement ?) pas été le cas. Les groupes de détritus se déplacent avec les courants, alors on doit conserver le même cap en espérant trouver des saletés. De temps en temps, on voit différents types d’épaves flotter plus ou moins côte à côte, mais le plus souvent, c’est juste un flot régulier de déchets isolés. C’est un peu décevant au début, mais rappelez-vous qu’on est au beau milieu d’une des plus grandes étendues d’eau de la planète. Le fait que pendant la majeure partie du voyage, je n’ai pas pu regarder par le hublot sans voir flotter quelque chose, laisse présager du pire quant à l’état du reste de l’océan.
Au début, quand on apercevait des ordures, on mettait un point d’honneur à arrêter le bateau et à sortir pour les recueillir. On remontait n’importe quelle saleté à l’avant du pont. Puis on a recueilli uniquement ce qui avait l’air intéressant. Une partie de nos prises était composée de trucs cool tombés de cargos, comme des caisses de masques de hockey et de baskets Nike. Vous avez peut-être entendu parler de la cargaison de canards en plastique qui a été perdue en mer dans une tempête en 1992, et que les océanographes ont utilisée pour dessiner les courants marins avec plus de précision ? J’imagine que c’est le bon côté de la situation, mais c’est comme si on remerciait le Sida et le choléra d’avoir fait avancer les recherches épidémiologiques.
Le problème avec le débat sur l’écologie, c’est que personne ne comprend vraiment de quoi il retourne. Se forger une opinion sur les changements climatiques, la surpopulation ou le pic pétrolier, c’est se fonder sur des divergences statistiques tellement microscopiques que même les scientifiques ont du mal à comprendre. Tout est tellement confus qu’on voudrait parfois qu’il arrive quelque chose de franchement horrible pour mettre tout le monde d’accord. Un truc grave qu’on pourrait prendre en photo et commenter comme ça : « T’as vu ? On est niqués. » Ce truc, j’en ai été témoin : une partie de l’Océan Pacifique est condamnée à être en permanence saturée de déchets. Je l’ai vu de mes propres yeux.
Au milieu des années 1990, Charles Moore rapatrie son catamaran de course de Hawaii à la Californie. Pour rigoler, il décide de passer par le centre de l’enroulement du Pacifique Nord. L’enroulement est un énorme vortex de courants qui tourbillonnent autour d’une zone de haute pression constante—si vous vous représentez le reste du Pacifique comme une énorme cuvette de WC, cette zone est l’endroit où votre merde tournoie à la surface avant d’être aspirée. Mais comme cet endroit est un piège mortel sans un pet de vent, les bateaux l’évitent soigneusement. Quand Moore l’a traversée, il n’y avait que lui, son équipage et une traînée infinie de déchets.
Le centre de l’enroulement a toujours été une zone d’accumulation naturelle pour toutes les saloperies à la dérive. Il était une fois des épaves qui flottaient en cercle autour de l’enroulement et qui—parce que jusqu’au siècle dernier tout ce qui existait était biodégradable—se transformaient en un ragoût riche en nutriments, boustifaille idéale pour les poissons et les petits invertébrés. Puis on s’est mis à tout fabriquer à partir du plastique, ce qui a bouché les toilettes, pour filer la métaphore.
Le problème avec le plastique, c’est qu’il ne se désintègre jamais totalement. On peut, à la rigueur, le compacter jusqu’à ce qu’il ait la taille d’un diamant. Avec le temps, le plastique est entièrement photodégradable, jusqu’à ses polymères individuels. Mais ces petits trucs sont toujours là, et pour longtemps. Ça veut dire qu’à part quelques poignées de plastique biodégradable, toutes les molécules synthétiques jamais créées ne disparaîtront jamais. Et, mis à part le faible pourcentage qu’on retrouve pris dans un filet ou échoué sur le rivage, chaque morceau de plastique jeté dans le Pacifique se retrouve au centre de l’enroulement et y flotte en ce moment même.
Après avoir passé près d’une semaine à observer les déchets s’amasser contre la coque de son embarcation, le capitaine Moore a décidé de transformer son bateau en navire de recherche, et de se rendre deux fois l’an à l’enroulement pour y étudier les déchets. Je l’ai accompagné lors de son dernier voyage. L’équipage était composé d’un docteur, quarantenaire, divorcé, et d’une chimiste mexicaine, mère de deux enfants. C’était comme des vacances en famille, en plus scientifique et plus compliqué à organiser. La nappe de déchets se trouve à l’un des points les plus éloignés du monde. Il faut une bonne semaine en mer rien que pour s’y rendre. On sait combien une journée en voiture peut être une torture, alors on imagine bien les dégâts au cerveau que peuvent provoquer sept jours à bord d’un bateau de 25 mètres. Le premier jour, on perd de vue la terre ferme, puis on ne voit plus les autres bateaux, puis on ne voit plus rien à part des vagues à perte de vue et parfois un oiseau de mer. Après des jours à ne voir rien que de l’eau, une mouette devient aussi palpitante qu’un OVNI. Juste quand on se retrouve avec une chanson différente pour chaque oiseau recensé dans le guide du bateau et qu’on les a toutes rassemblées pour en faire un opéra dédié aux oiseaux de mer, on aperçoit les déchets.
J’ai pensé spontanément, sans me servir de mon bon sens, que le capitaine nous conduirait vers une masse de déchets contigus, mais ce n’a (malheureusement ?) pas été le cas. Les groupes de détritus se déplacent avec les courants, alors on doit conserver le même cap en espérant trouver des saletés. De temps en temps, on voit différents types d’épaves flotter plus ou moins côte à côte, mais le plus souvent, c’est juste un flot régulier de déchets isolés. C’est un peu décevant au début, mais rappelez-vous qu’on est au beau milieu d’une des plus grandes étendues d’eau de la planète. Le fait que pendant la majeure partie du voyage, je n’ai pas pu regarder par le hublot sans voir flotter quelque chose, laisse présager du pire quant à l’état du reste de l’océan.
Au début, quand on apercevait des ordures, on mettait un point d’honneur à arrêter le bateau et à sortir pour les recueillir. On remontait n’importe quelle saleté à l’avant du pont. Puis on a recueilli uniquement ce qui avait l’air intéressant. Une partie de nos prises était composée de trucs cool tombés de cargos, comme des caisses de masques de hockey et de baskets Nike. Vous avez peut-être entendu parler de la cargaison de canards en plastique qui a été perdue en mer dans une tempête en 1992, et que les océanographes ont utilisée pour dessiner les courants marins avec plus de précision ? J’imagine que c’est le bon côté de la situation, mais c’est comme si on remerciait le Sida et le choléra d’avoir fait avancer les recherches épidémiologiques.