J’ai cherché pendant des heures le meilleur moyen d’introduire Transsiberian back to black d’Andreï Doronine. J’aurais pu vous parler de la face cachée de Saint-Pétersbourg, de l’auteur – né en 1980, ancien toxicomane – ou encore des différentes histoires qui composent ce bouquin, traduit du russe par Thierry Marignac, l’homme derrière la collection Zapoï de la Manufacture des livres. En lieu et place d’une introduction qui n’aurait pas fait honneur à un récit qui brille par sa concision et son réalisme cru, je vous dirai simplement que j’ai rarement autant ri à la lecture d’un texte violent et sordide, qui narre les pérégrinations de camés sans le sou, perdus dans des environnements hostiles, des lieux inhospitaliers, des relations humaines détestables.
Du voyage mystique de quelques addicts dans des plaines glacées à l’évocation d’un homme amené à se coller à un cadavre pour passer inaperçu dans un hôpital, la noirceur de Transsiberian back to black n’a d’égal que sa légèreté. « Légèreté, alors que des types crèvent sous nos yeux ?? », vous indignerez vous. Et c’est bien normal. Crever à petit feu, se shooter avec un stylo ou arracher les boucles d’oreilles des passantes, ça n’a rien pour faire sourire. Sauf qu’ici, sous la plume de Doronine, un type qui a fait demi-tour au mitan de sa traversée du Styx, la légèreté n’est rien d’autre que l’absence de jugement. Certes, des types agonisent, des jeunes filles agonisent, des vieillards agonisent – toute une partie de la ville agonise, prise au piège des substances les plus crasses. Mais rien, dans Transsiberian back to black, n’a valeur de jugement. Et c’est ce qui en fait sa plus grande force. Pour que vous vous en rendiez compte, on vous file un chapitre entier.
Videos by VICE
Inventeur
La barre de Snickers aide beaucoup de gens à tenir quand ils ont le moral à zéro. Une barre allongée qui, de loin, rappelle un étron. Comme le promet la publicité, à l’intérieur, un feu d’artifice complet de plaisirs variés. Des arachides, un nougat inconnu au bataillon et… oh ! Qu’est-ce qu’on ne trouve pas dans ce truc-là. La combinaison de tout ça, augmente le tonus, recharge le cerveau et encore tout un tas de foutaises.
Pour moi, ça se passe un peu différemment. Quand j’ai le moral non pas à zéro mais carrément dans les chaussettes, ça me fait vaciller périodiquement, et ça m’énerve encore plus, à la place de la barre de Snickers, surgit chez moi la tension. Qu’est-ce que c’est ? Référons-nous à la définition officielle : la tension, c’est le désir obsédant, indéfini, de faire usage. Usage de quoi ? Je crois que ça se comprend de soi-même.
Poursuivons notre lecture. La tension prend des formes différentes et dissimulées, qui s’expriment dans des accusations d’importance croissante contre les autres, une mauvaise humeur contre le monde environnant. En bref, c’est tous des enfoirés. Bon, je ne nierais pas catégoriquement qu’il y ait une part de vérité là-dedans. Il suffit d’aller faire un tour au marché Apraskine pour s’en convaincre. Qu’est-ce que vient faire la tension dans le tableau ? Elle survient à un certain moment.
Plus je me trouve dans ce genre d’état, plus il m’est difficile d’en sortir, sans me précipiter sur un Snickers quelconque. Chez moi, c’est un processus assez simple. Je commence à me souvenir de toutes les occasions où, dans le but qu’une poudre dans un petit paquet papier d’alu – pour parler comme les flics –, qui a été avalé et chié dans les toilettes d’un appartement collectif cradingue, par le dernier Pablo Escobar tadjik en date, ayant réussi à franchir les frontières, dans le but, donc, que cette poudre circule dans mes veines, j’ai entrepris des miracles surhumains de débrouillardise et de vivacité d’esprit.
À cet égard, l’histoire du stylo est très instructive. Assez tard, une nuit, en possession d’une belle quantité de poudre que je serrais dans un poing à la paume moite de peur, je découvris soudain que je n’avais pas le moindre matos pour me faire une piqûre. C’est-à-dire, vraiment rien. Pas une seule shooteuse. Et pas une seule pharmacie à quinze kilomètres à la ronde, de n’importe quel côté que l’on se tourne. Après avoir procédé à une fouille minutieuse, je remarquai non sans quelque orgueil que j’aurais pu travailler dans les rangs du NKVD et perquisitionner chez les ennemis du peuple, sauf que les temps avaient changé.
J’avais tellement envie de me faire un fix que je grinçai des dents. La démarche incertaine, je sortis dans la nuit chercher une shooteuse abandonnée dans la rue par quelqu’un. L’examen des immeubles à proximité de chez moi donna les résultats suivants : un rat crevé, un seul exemplaire, un clodo paisiblement endormi, un seul exemplaire, bouteilles de bière vides, deux exemplaires. Pas la queue d’une seringue.
Luttant contre l’envie de tout sniffer, j’arpentais l’appartement les mâchoires bloquées. Eurêka ! La joie m’emplit tout entier. Je me jetai sur l’ordinateur et me mis à creuser les connaissances acquises sur Internet. Un quart d’heure plus tard, j’étais assis dans la cuisine. Au fond, ce n’était vraiment pas si compliqué. L’idée était relativement simple : j’avais une sorte d’aiguille de seringue, le stylo à bille, et de la défonce. Il fallait juste restructurer le stylo pour que ça devienne une pompe valable.
L’aiguille se présentait comme si les concepteurs de matériel pour écrire s’étaient bouffé le nez en élaborant la forme qu’elle aurait :
– Kolia, tu racontes des conneries, un bout émoussé, et si quelqu’un veut se shooter avec ? Vas-y aiguise-moi ça.
– Ouais, c’est vrai, qu’est-ce que je raconte, aurait grommelé Kolia avant de perfectionner son dessin.
Il restait à résoudre la question du système de piston. Il fallait que ça fonctionne au moins une fois. C’est-à-dire que l’espace entre les parois et le piston lui-même ne devait pas laisser échapper le précieux nectar. De la gomme tchèque. Seigneur, un peu d’endurance et de patience, et hop – j’avais devant moi une seringue, quoiqu’un peu tordue. Ensuite, la note des travaux pratiques après expériences avec de l’eau était de 3 sur 5.
Je remarquai avec surprise que je m’étais affairé pendant près de deux heures, sans m’être souvenu une seule fois que j’étais en manque. Bon. En avant. Il était clair qu’on ne pouvait contrôler par une tirette si on avait tapé dans la veine, donc il fallait taper dans l’artère principale, à l’époque encore accessible. C’était même plus une voie centrale, c’était un puits. Une plaie qui s’infectait, mais n’avait pas le temps de durcir et de se refermer parce que l’aiguille perçait sans pitié la peau plusieurs fois par jour. J’ai soupiré. Je me suis garrotté le bras, comme font tous les toxicos au cinéma. Allez, hop, envoyé. Le piston tient le coup. C’est bon.
Évidemment, j’en ai foutu en l’air les deux tiers. Les larmes de crocodiles, ça n’était rien à côté de celles que je répandais. Je m’apitoyais sur moi-même. Le génie de l’invention et ma banale précipitation m’avaient joué un sale tour.
Quand on est en manque, les mains tremblent traîtreusement pendant qu’on prépare sa dose. La cuillère n’en fait qu’à sa tête, et oh ! cauchemar, son contenu déjà bouillonnant comme de la soupe se répand par terre. Je vis dans une baraque standard de prolos soviets, alors il y a un tapis. Un tapis ordinaire, élimé, qui en a vu beaucoup. Et maintenant, il y a dessus une petite tache qui s’élargit dans tous les sens. Et cette tache, c’est mon repos et mon sommeil d’aujourd’hui. Et plus cette tache noircit, plus je pige avec acuité, que je ne pourrai pas me sentir dans mon assiette aujourd’hui.
Et ça n’est pas seulement parce que je regrettais la poudre gâchée. Bien sûr, que je la regrettais. Mais j’en étais, au niveau de la défonce, au stade où toutes ces fabuleuses montées du début sont déjà loin derrière, à présent je me shootais juste pour pouvoir marcher droit et pouvoir boire ne serait-ce que du thé, vu que la nourriture n’était pas une nécessité première. Je poussai un cri de hyène et entamai la danse du désespoir. Autant de chance de m’embourber une nouvelle dose que de rencontrer des extraterrestres en allant chercher du pain à Kouptchino.
Le produit du travail des tisserands du peuple frère d’Azerbaïdjan absorbait le mélange, et j’allais rester en manque. En un éclair, je me précipite à la recherche de la lame de rasoir « Spoutnik ». De l’acier trempé. Dans les films, c’est avec ça que les ratés et les pleurnichards se coupent les veines. Je découpe avec soin le bout du tapis où s’étale la tache. Après, je le fourre dans un flacon de Naphthyzinum [Médicament contre la grippe, ndlt], je verse de l’eau et j’attends.
D’après mes calculs, le mélange répandu sur le tapis va se mélanger à l’eau, et j’obtiendrai un liquide dont je pourrai me servir. C’est ainsi qu’arriva l’heure « H ». J’ai tellement envie de cette défonce que je me fous de savoir que des centaines de gus ont marché sur ce tapis. Un certain nombre d’entre eux n’est plus de ce monde. Qui étaient-ils et quelle crasse pouvait se trouver sous leurs semelles ? Tout est possible… Et cela signifiait que j’avais en main le mélange que constituaient le stupéfiant et la saleté de cette ville, depuis cinquante ans incrustée dans les fibres du tissu. Très symbolique, mais je ne suis pas hygiénique pour un rond.
Piqûre, tirette pour contrôler que j’ai tapé dans la veine, cigarette, vague de chaleur. Stop, il y a quelque chose qui cloche. Très vite sur la vague de montée de la dope, une autre vague roula dans mes veines, différente de la première. Elle brisait les os et me faisait tirer la langue. Ça me cassait tellement le dos, que j’étais coupé en deux. Toute la défonce me sortait instantanément par les pores dans une sueur froide. Ça s’appelle « cahoter », quand on s’est mis de la poussière dans le sang avec la dope.
Ça a des conséquences très diverses. Par exemple, le père de Maïakovski, qui s’était piqué avec une seringue rouillée est mort d’une septicémie. Chpinat, une de mes connaissances, est resté toute sa vie avec la tronche de travers. Je pouvais aussi bien traîner dans la rue et ramasser encore plus de cochonnerie, pour me concocter un poison du même genre. L’enfer ne faisait que commencer.
Mais j’aimais tellement la défonce. Et je l’aime toujours. C’est précisément pour ça que je n’y touche plus. Effectivement comment vivre lorsque, par amour, on est prêt aux humiliations et aux tortures les plus raffinées, pour une minute, une seconde d’espoir que ça sera comme la première fois ?
Le visage des passants fait moins horreur, et la musique du centre commercial ne donne plus envie de vomir. Ça veut dire qu’on n’est plus en manque. On s’en est débarrassé, tant qu’on ne recommence pas à se battre avec lui et le monde pas très sympathique qui s’ensuit.
Mais j’ai encore une tonne d’histoires à raconter, alors on va continuer à se battre.
« Transsiberian back to black » d’Andreï Doronine est publié chez la Manufacture des livres . Commandez-le sans attendre.
Romain est sur Twitter.
More
From VICE
-

Photo: dbvirago / Getty Images -
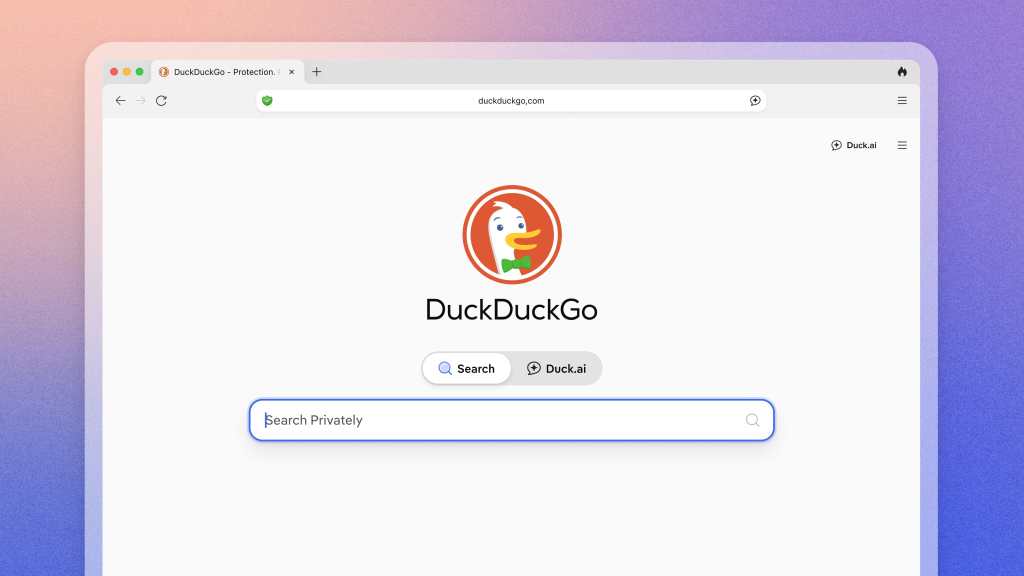
Credit: DuckDuckGo -

Photo: Oleg Breslavtsev / Getty Images -

Photo: HEX / Getty Images
